L’archéologie tente, vaille que vaille, de proposer des pistes pour comprendre les vestiges culturels de groupes humains. S’il est vrai que nous bénéficions souvent de nombreux indices sur les groupes dirigeants au travers d’ensembles monumentaux et d’objets somptuaires, les médias (et parfois même les chercheurs eux-mêmes) laissent de côté des vestiges plus humbles qui nous donnent cependant de précieuses informations sur les gens du commun et leur vie quotidienne. L’architecture domestique est certainement un des aspects les plus significatifs de l’humanité, de sa capacité, non seulement parce qu’elle dénote leur perception d’un espace restreint mais aussi parce qu’elle connote leur relation à leur environnement en termes de ressources et d’organisation sociale.
Le fait que la revue co-publiée par l’éditeur Raíces et l’Institut National d’Anthropologie et d’Histoire nous fasse réfléchir sur la maison mésoaméricaine est a priori une excellente idée. C’est David Carballo, professeur à l’Université de Boston, qui s’est chargé de l’introduction générale pour ce dossier : il s’attarde notamment sur le nom donné à la maison dans différents groupes et explique la grande diversité de ce qui a pu servir de foyer au cours du temps mésoaméricain. Il insiste sur la maison comme un espace de production collective et lieu de repos pour les défunts.
Suit une description diachronique de la maison à travers différents groupes ou sites archéologiques. La Dr. Ann Cyphers, spécialiste de la culture olmèque, décrit les tendances et la distribution des unités domestiques sur le site préclassique de San Lorenzo.
Postérieures aux demeures olmèques, les unités domestiques décrites par Patricia Plunkett et Gabriela Uruñuela, pour le Haut plateau central correspondent aux sites de Tlatilco, Chalcatzingo, Loma Torremote, ou Tetimpa que les archéologues de l’Université des Amériques ont récemment fouillé. Elles ont notamment pu établir que les greniers traditionnels appelés cuexcomates étaient déjà présents sur ce site.
http://api.ning.com/files/nTtFTXKY8NnH9V5pacLx6lFOLO7jvtHuYnnyBmBCMg*Fjpj34BLI718bSMyJXiytVNEXzDYOPMfo77aAkPtUUa35WxCYKop*/IMG_5692.JPG?width=450&height=600
Photo: Hugo / RMA, disponible le 14/08/2016.
La lecture de la revue se poursuit avec un très bon exposé de l’expérimentée Joyce Marcus. La professeur de l’Université du Michigan s’attarde sur le site de San José Mogote, actuellement dans l’état d’Oaxaca, à quelques kilomètres de la capitale homonyme et de sites zapotèques plus récents comme Monte Alban ou Atzompa. Elle insiste notamment sur l'efficacité d’un système d’écoulement et de captation des eaux dont l’ancienneté remonterait entre 1000 et 850 avant notre ère ! Les fouilles ont permis de déterminer des zones d’activités par sexe.
Suit un résumé des travaux de l’équipe de Linda Manzanilla sur le cas Teotihuacan, éminemment plus complexe que les antérieurs et éventuellement les suivants. L’égyptologue de formation connaît bien la grande mégalopole que fut Teotihuacan. Elle a dirigé des fouilles dans des complexes habitationnels de dimensions, d’organisations et d’occupants différents. Elle s’attarde volontiers sur le petit complexe d’Oztoyahualco : il s’agirait du premier exemplaire mésoaméricain de logement multifamilial. En gros, trois familles possédaient son “appartement” avec sa cuisine, ses chambres, ses réserves et son autel personnels. Les trois petits ensembles étaient regroupés autour d’un espace rituel commun, le tout étant fermé par un haut mur qui limitait son accès. En fait ces familles semblaient être réunies parce qu’elle partageaient une activité professionnelle commune.
On part vers l’Occident du Mexique avec l’archéologue Martha López Mestas Camberos. Ne nous leurrons pas : présenter au moins trois mille ans de sédentarisation autour du volcan de Tequila ou dans les Tombes à puits relève de la gageure, surtout en quatre pages ! L’idée est plutôt d’introduire le lecteur à cette région culturellement complexe. Les simples maisons en miniature mériteraient un numéro rien que pour elles !
Avec Eduardo Gamboa, le lecteur (re)découvre la manière dont la culture Casas Grandes a développé des variantes propres d’unités domestiques à Paquimé, conformément au paysage où elle a évolué, mais aussi en rapport avec les échanges culturels et commerciaux. L’auteur s’intéresse notamment à l’unité 11, appelée également Maison des aras, et l’unité 14, ou maison des Piliers.
De son côté Luis Barba Pingarrón nous explique comment l’étude chimique des sols préhispaniques utilisée à la fin des années 1970 est devenu un paradigme dans l’archéologie moderne, permettant de détecter les différentes aires d’activités, notamment dans les unités domestique. Grâce à la concentration des phosphates, aux valeurs de pH ou à la distribution des acides gras, on peut désormais facilement établir les espaces de préparation et de consommation des aliments, ceux réservés aux réserves et au repos.
La partie ethnographique de ce dossier revient à David Robichaux. Le chercheur de l’Université Ibéroamerícaine a documenté un cas très intéressant dans l’état de Tlaxcala où la résidence post-maritale et les liens patrilinéaires expliquent l’héritage non seulement du terrain mais aussi de l’unité domestique.
En s'intéressant aux cultures de l’Occident et à celles du nord du Mexique, on sort à proprement parler du modèle kirchoffien de la Mésoamérique. Rien en revanche sur les unités domestiques à Tula Chico ou dans la vallée de Mexico où, même si les données archéologiques sont partielles, on dispose d’éléments intéressants pour élargir le spectre. Ces choix éditoriaux sont quelque peu surprenant, quand bien une perspective plus globale offre un enrichissement non négligeable
Pour éviter la frustration naissante, le lecteur devra se replier sur les numéros 85, 120, 136 pour les. Rien non plus sur la maison maya préhispanique : il faudra là aussi chercher dans la longue liste des numéros d’Arqueología mexicana s’intéressant à ces peuples. De fait, certains spécialistes pourront arguer du fait que ni les traditions occidentales, ni le site de Casas Grandes ne correspondent aux limites géographiques et culturelles de la Mésoamérique telle que la proposait Kirchhoff.
En marge de ce dossier, on pourra lire un article collectif sur les objets en bois du Templo Mayor de Tenochtitlan. D’autre part Emiliano Melgar Tisoc et Reyna Solís Ciriaco se sont interrogés sur la provenance et la manufacture des objets en jadéite retrouvés dans les offrandes du même site archéologiques. Enfin un dernier papier, proposé par Javier Urcid, reprend et critique une proposition faite par Bernard et Taladoire dans le numéro 132 d’Arqueología mexicana sur une vaisselle en pierre conservée au Musée ethnographique de Berlin. Le chercheur de l’Université Brandeis à Boston considère plus plausible la ressemblance de la tête de canard endormi gravé sur la pièce à celle d’un épi de maïs.
En ce qui concerne les rubriques traditionnelles de ce numéro, on trouvera une rapide présentation des illustrations de Francisco Hernández, médecin du vice-roi de la Nouvelle-Espagne. En l’espace de quatre années, entre 1572 et 1576, il dressa un impressionnant inventaire intitulé Historia natural de la Nueva España. Eduardo Matos Moctezuma revient sur la figure de Don Francisco del Paso y Troncoso, médecin, archéologue, historien et philologue.
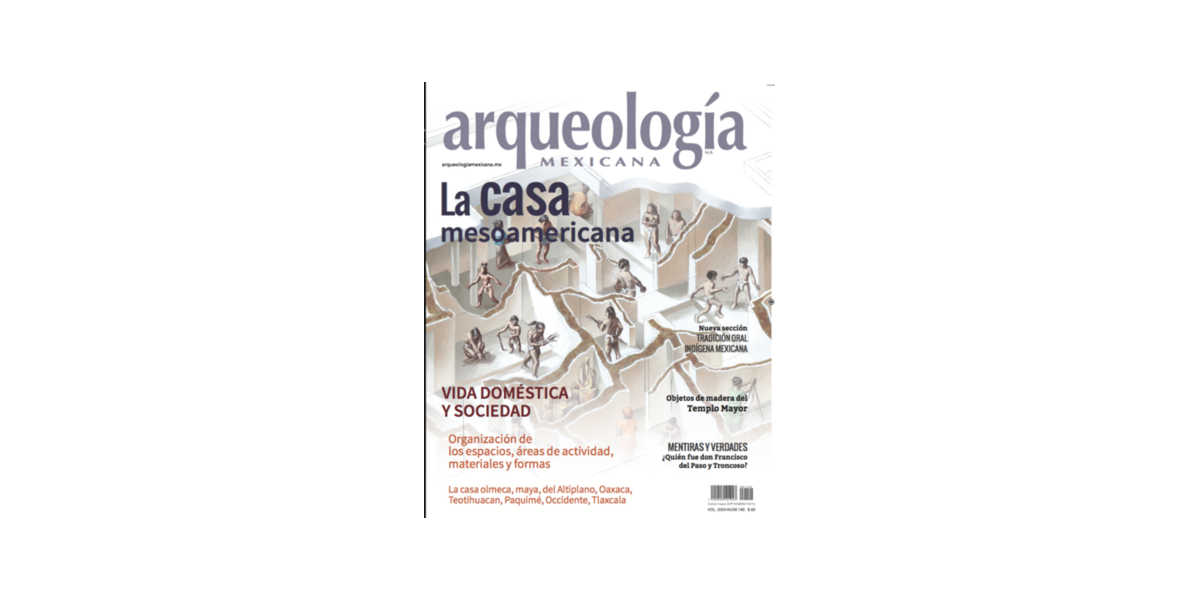
Commentaires